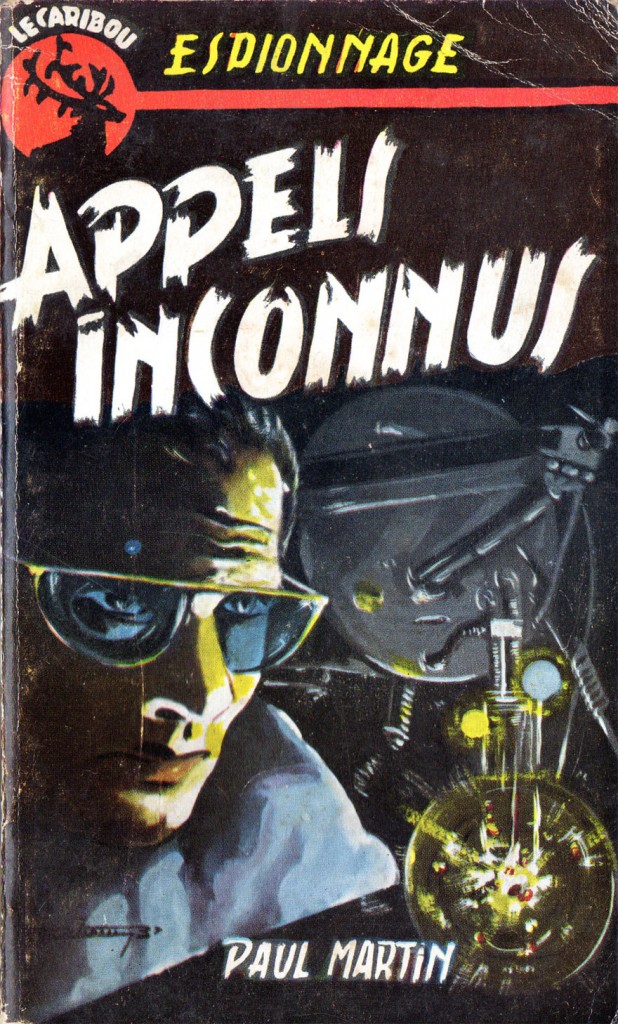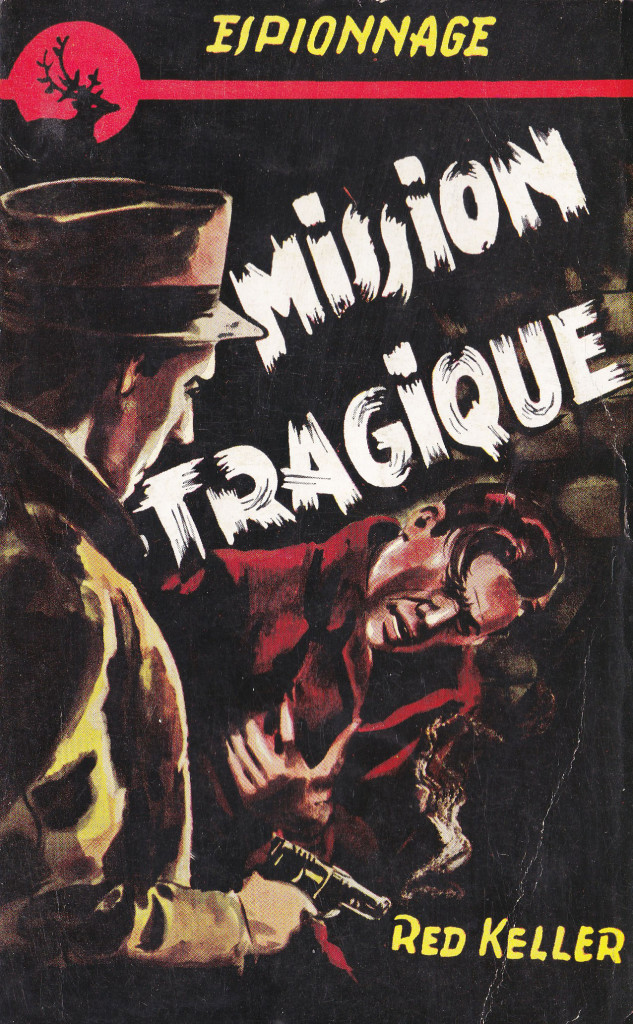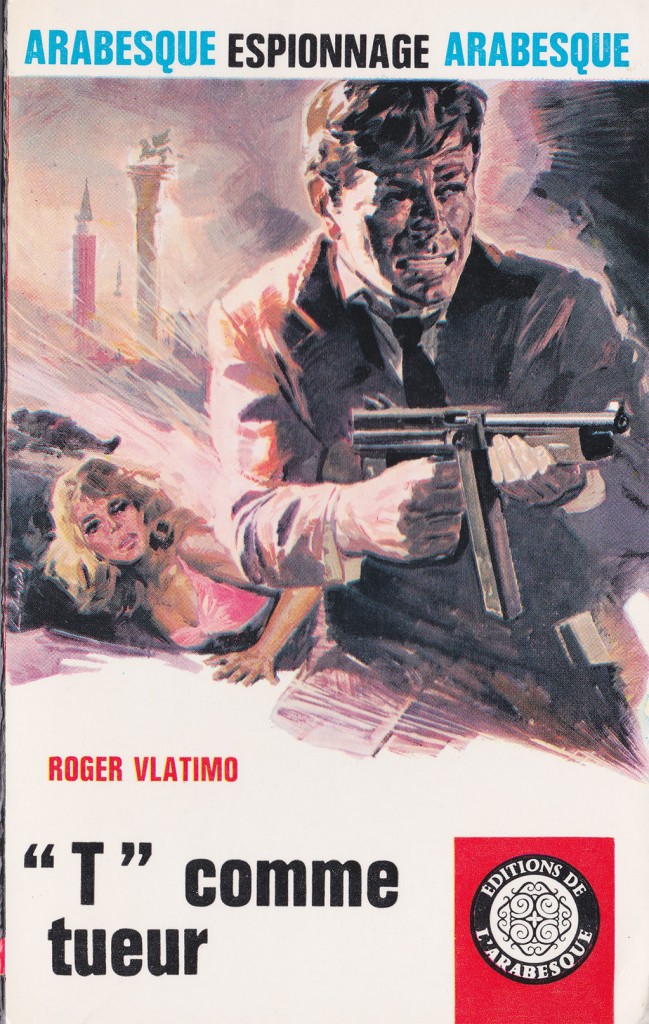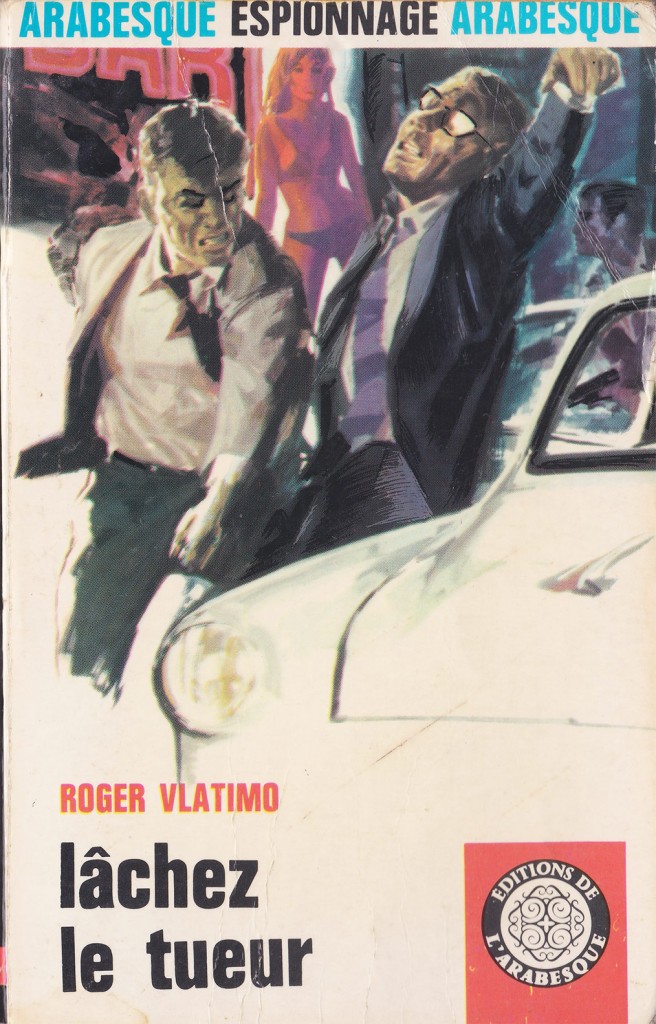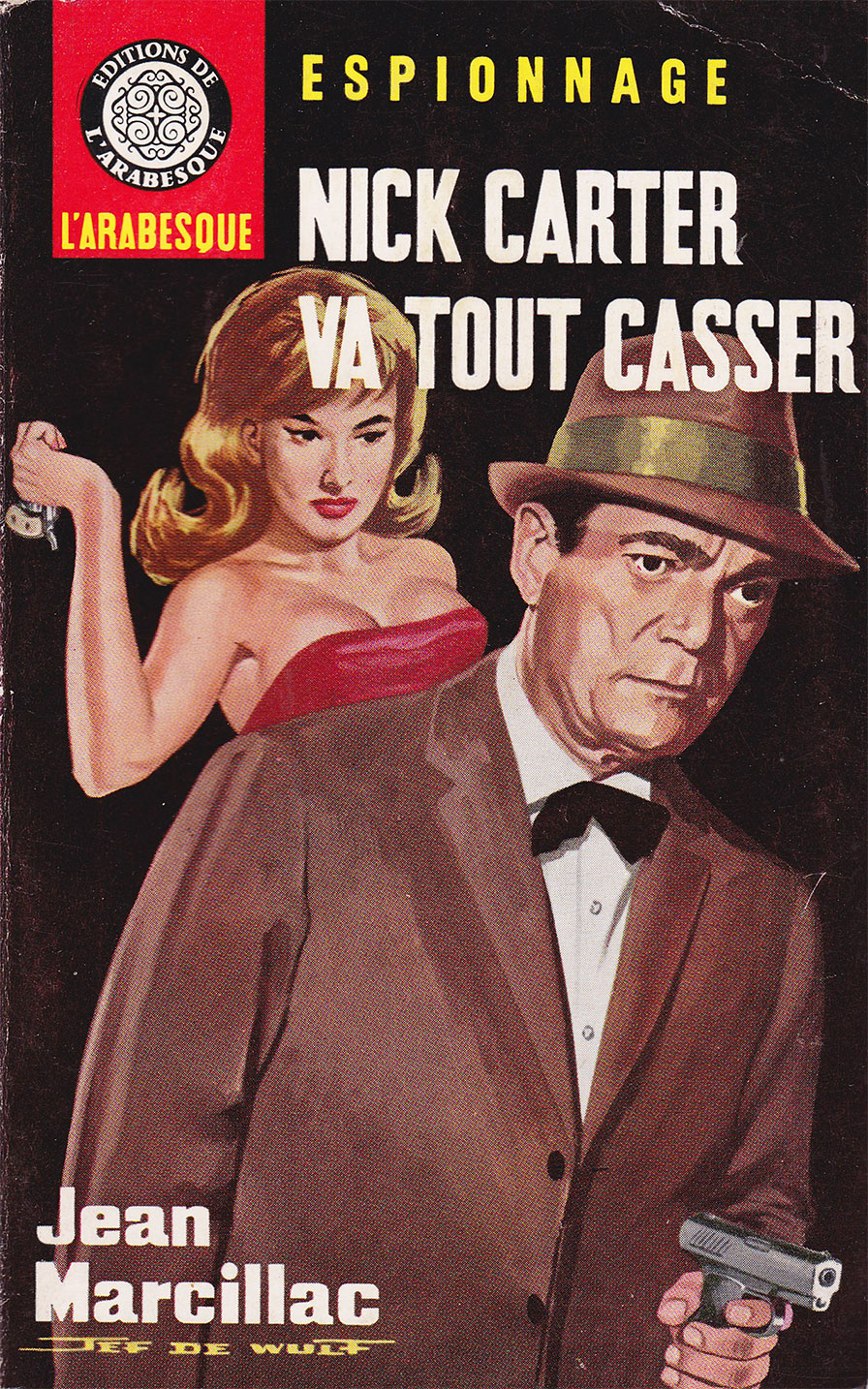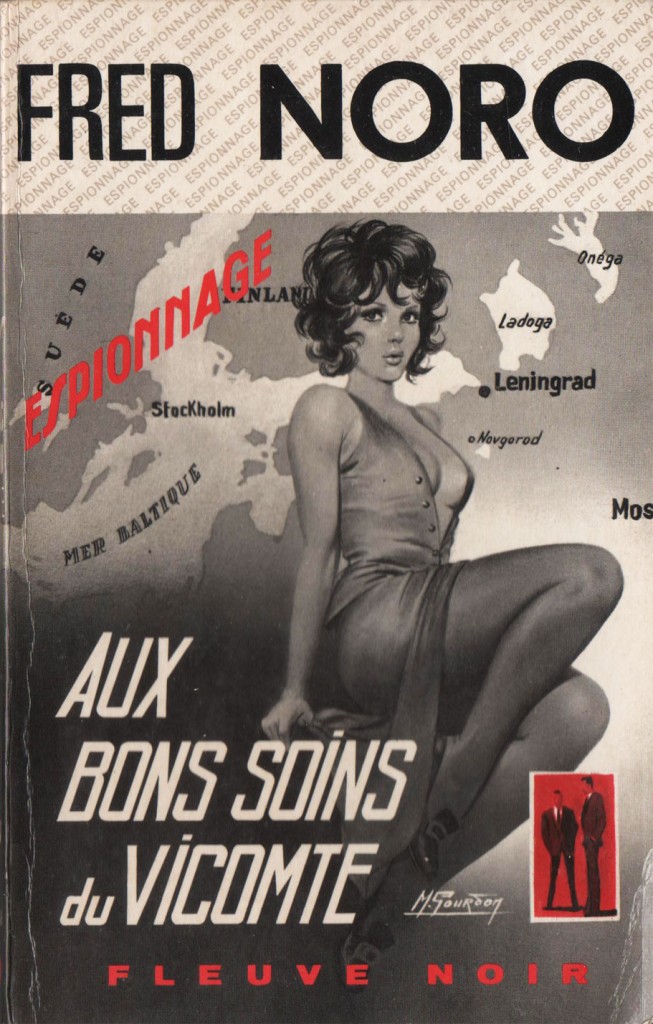Si, selon Héraclite, on n’entre jamais deux fois dans un même fleuve, il est par contre parfaitement possible, dans le registre de la filouterie littéraire, d’ingérer à de multiples reprises la même soupe.
Ainsi, ce premier roman de George Maxwell, Laboratoire de mort lente (C.P.E. / Contre-espionnage # 7, 1952), que je pensais ne pas avoir lu alors que je me l’étais déjà bien fadé trois ans plus tôt sous un autre titre, signé d’un autre pseudonyme et publié chez un autre éditeur.
George Maxwell, l’amateur de roman de gare le connait surtout pour des séries de polar violents et énervés dans lesquelles des femmes aussi fatales que déterminées – La môme Double-Shot, Miss One-Shot, Miss Luger, le Jaguar, Miss Bomb Baby – dament le pion aux traditionnels gangsters et détectives privés du hardboiled à l’américaine.
Mais avant de se faire un nom dans le registre bien particulier du sexy-noir, Maxwell signa une poignée de récits d’espionnage plus traditionnels, inspirés par le succès des Lemmy Caution de Peter Cheney : Espions à Frisco, Alerte aux F.B.I., Tous des pourris (qui, si mes souvenirs sont bons, donne plutôt dans le pastiche de James Hadley Chase) ou bien encore ce fameux Laboratoire de mort lente.
Dans ce roman, l’agent secret Max Baker, matricule X.107, est envoyé en Autriche afin d’enquêter sur la mystérieuse disparition de deux collègues du service. Enquête peu folichonne. Baker pratique un espionnage pédestre et campagnard, effectuant ad libitum des aller-retours entre la cahute en bois de son correspondant autrichien et la louche usine hydraulique en construction qui abrite sous ses fondations le laboratoire secret des méchants S.S.
En bon pithécanthrope du bouquin d’action, Baker enchaîne aussi les bagarres, transformant à coups de poing et de pied le visage de ses adversaires en « pâte molle » puis les questionnant en leur brûlant les oreilles avant de s’en débarrasser d’un coup de surin dans la nuque, méthode qu’il prise pour son aspect parfaitement indolore (« […] le S.S. n’eut même pas le temps de réaliser qu’il s’en allait tout droit au Paradis des Waffen. »)
Afin de relancer un brin l’intérêt du lectorat somnolent, apparaît dans le dernier tiers une aguichante fraülein nazie, « bête sanguinaire et détraquée, capable du pire avec un tranquille assurance et, peut-être, une singulière inconscience. »
Max couche avec elle puis la torture en sacrant « saloperie de gonzesse ! » – c’est le passage le plus chouette du livre – avant de conclure son aventure par une course poursuite en Mercedes et un dynamitage en règle du labo des méchants nazis.
Emballé, c’est pesé.
Tout cela, je l’avais donc déjà lu courant 2015. Le roman s’appelait alors Appels inconnus, était signé Paul Martin, avait paru en 1959 dans la collection Le Caribou d’André Martel.
Max Baker s’y appelait Guy Robin, « l’as du S.R. français, » et l’action se déroulait non pas en Autriche mais en Allemagne. Le premier chapitre était sensiblement différent. Le reste coulait à l’identique, avec parfois un peu plus d’alcool dans les veines.
Dans ma note pour ce blog, j’écrivais alors : « c’est une espèce de rejet des éditions du Trotteur, de ces bouquins à la George Maxwell période Double-Shot mais en avorté, en pas bien fini, un bras en moins et la tronche en vrac. »
Inconsciemment, j’avais tout juste.
Reste maintenant à dénicher d’autres Maxwell camouflés.
En fouillant dans ma collection de Caribou, je tombe sur Mission tragique, signé Red Keller.
Le résumé, au dos du bouquin, vend la mèche dans le style brinquebalant habituel : « San-Francisco. Les Chinois pullulent, les espions beaucoup trop – le F.B.I. s’inquiète et dépêche un de ses meilleurs agents : Duke – Mais voila, le nid de ces espions semble être la légation chinoise elle-même – alors c’est pas du tout cuit […] »
Au contraire, c’est du réchauffé. On reconnait là Espions à Frisco, le premier roman d’espionnage que Maxwell signa aux éditions du Trotteur de Roger Dermée.
Exactement comme pour Laboratoire de mort lente / Appels inconnus, le chapitre introductif diffère légèrement et le nom de l’espion change. Pour le reste, c’est du kif.
Toujours au catalogue du Caribou, se trouve un second bouquin signé Red Keller : Radar inconnu. Ne l’ayant pas dans mes cartons, je ne peux que spéculer. S’agit-il d’Alerte au F.B.I., le second espionnage de Maxwell chez Dermée, ou bien serait-ce un inédit ?
Mystère…
Demeure surtout une interrogation quant à l’origine de ces recyclages : George Maxwell, de son vrai nom Georges Esposito, en était-il l’artisan ou bien ceux-ci furent effectués par ses peu scrupuleux éditeurs, messieurs Dermée et Martel, et sans que l’auteur n’en soit informé ?
Pour le coup, il sera duraille d’avancer une réponse…
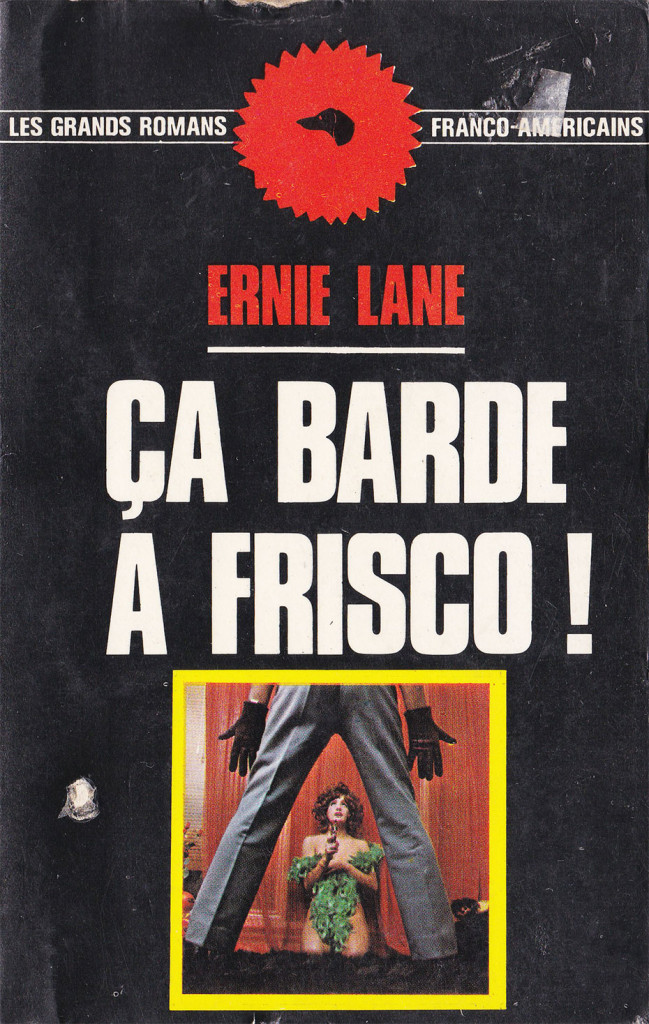
(La soupe coule à flot. Ci-dessus, une autre édition d’Espions à Frisco : Ça barde à Frisco, signé Ernie Lane. Éditions Bellevue, collection Les grands romans franco-américain # 6, 1973.)