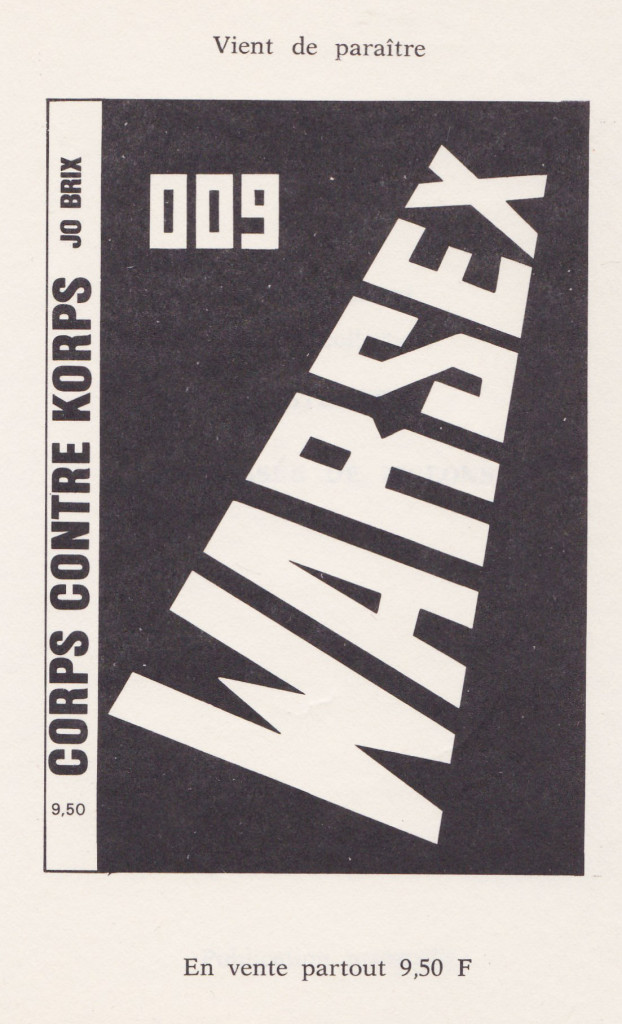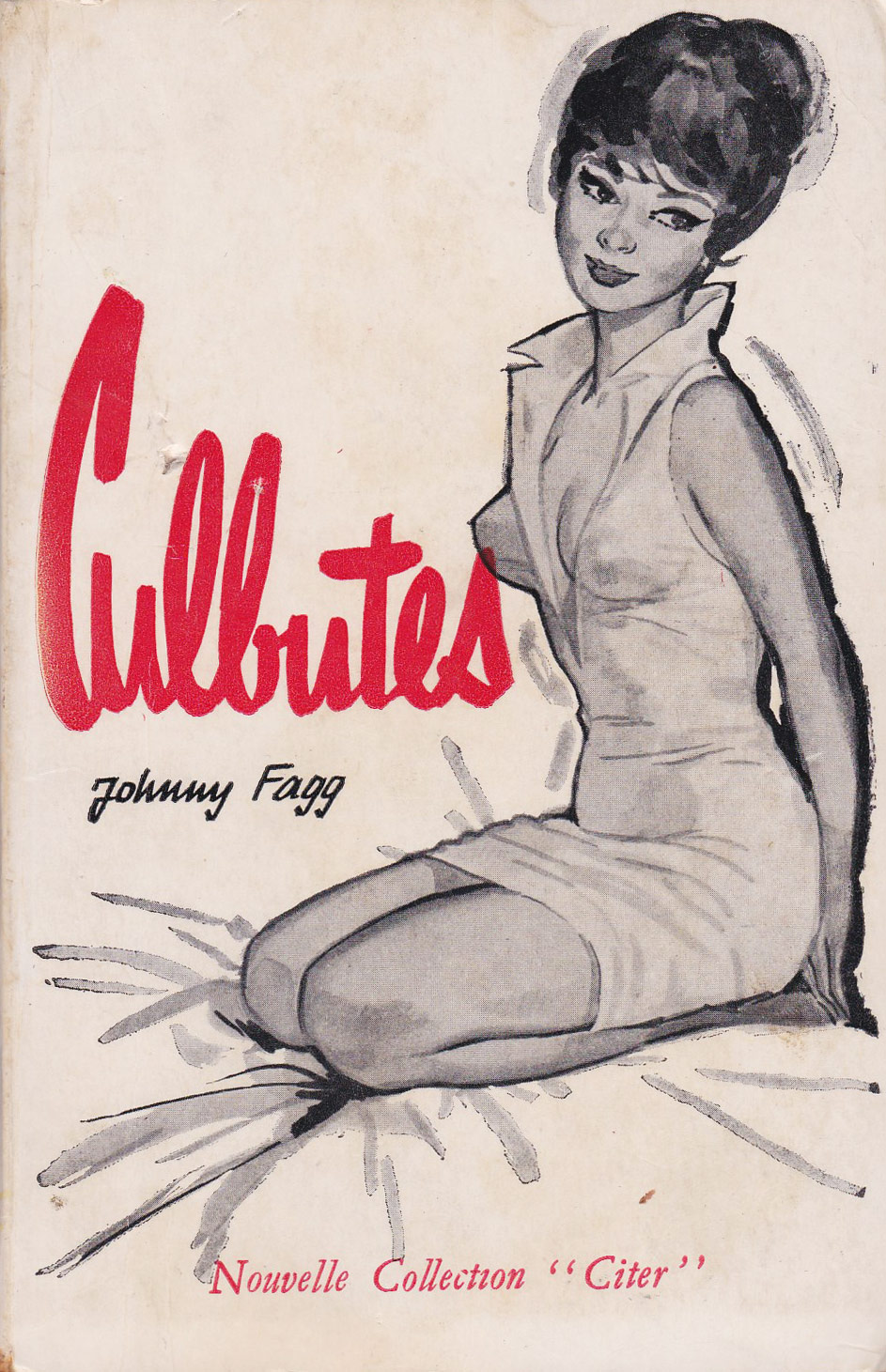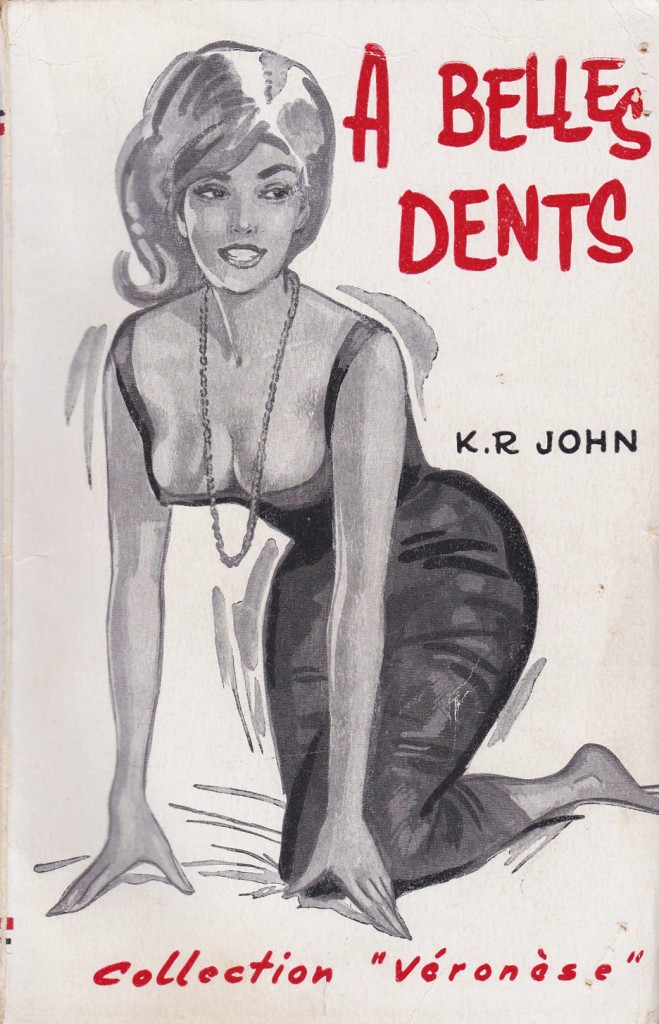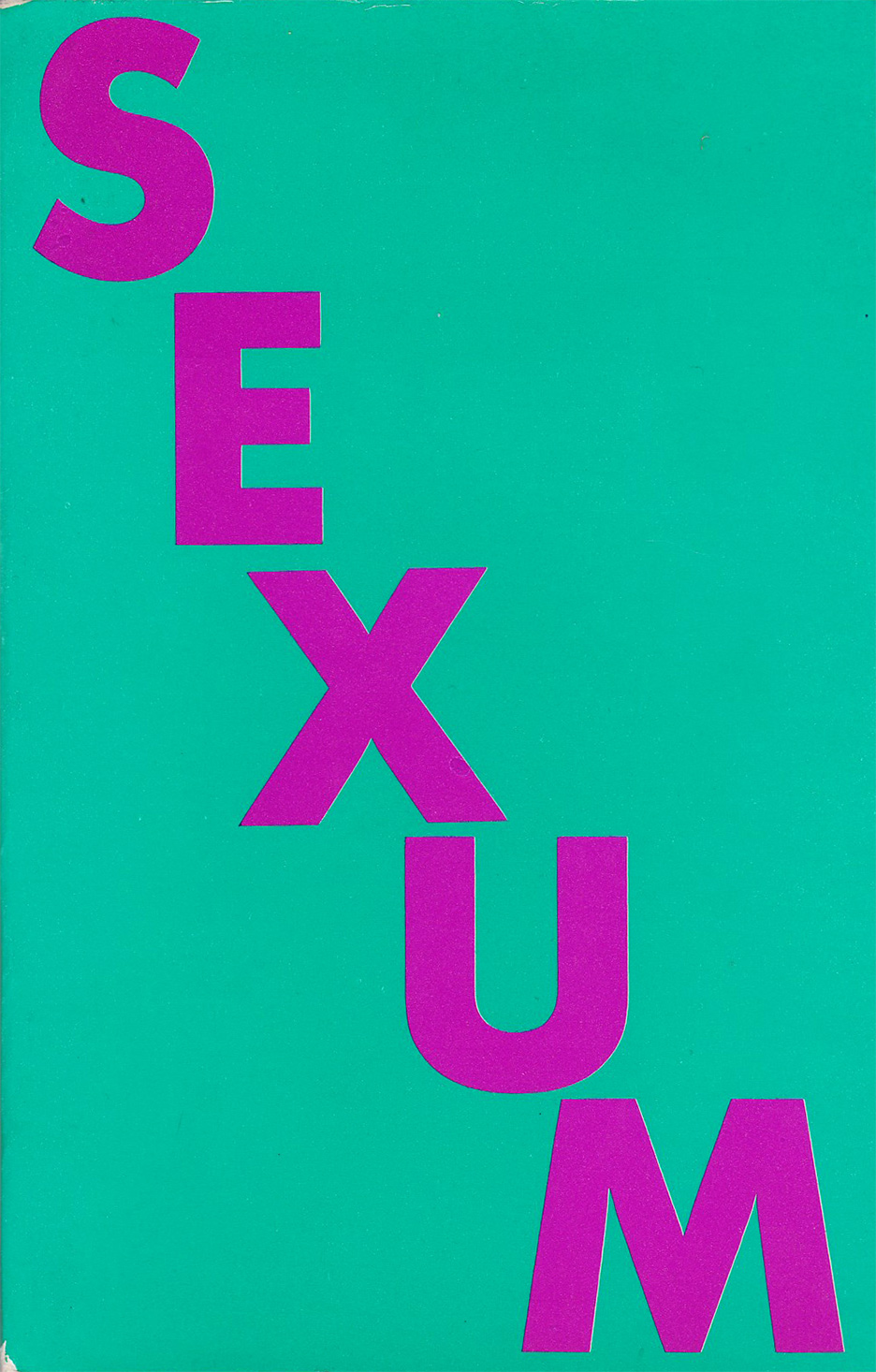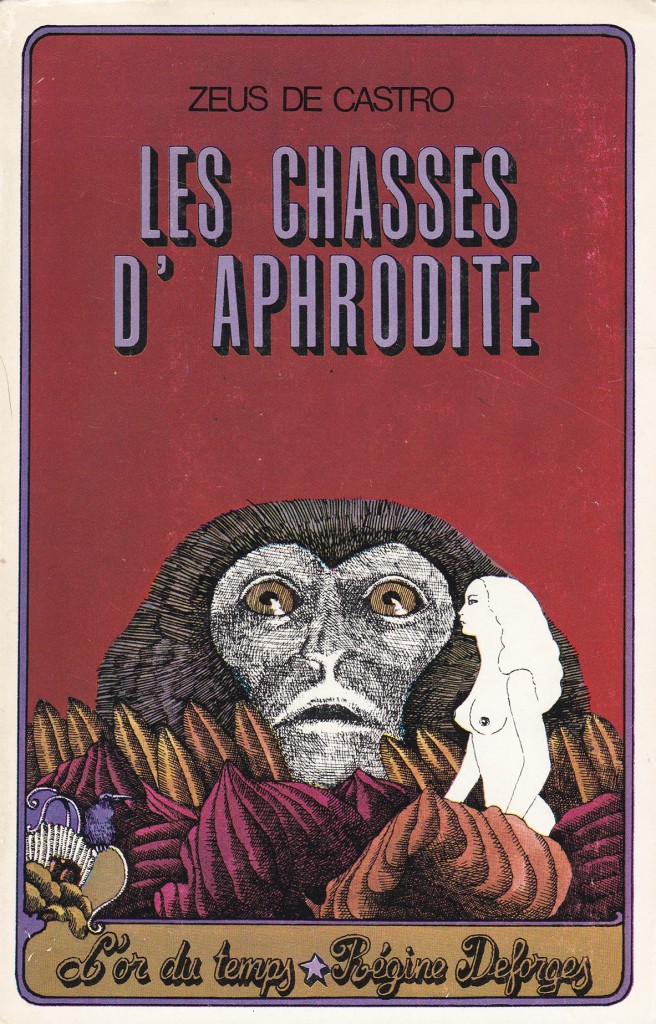Les éditions Promodifa occupent une place à part dans l’histoire de la littérature virile.
Si les universitaires tendance barthésienne connaissent le degré zéro de l’écriture, les auteurs de chez Promodifa, taupes modèles du style populo-laborieux, préféraient usiner au niveau moins trois.
Actif au cours des années 70, cet éditeur filouteux pratiquait un mélange de romance brutale (polar, espionnage ou récit de guerre) et de pornographie maniérée façon garçon-boucher mais d’où se trouvait bannie toute référence directe au pénis et au vagin, aux joyeuses et au tirelingue, à popol et à pollux.
En lieu et place des parties incriminées, l’auteur bricolait de réjouissants fourreaux soyeux et/ou humides que venaient percuter des glaives de chair brûlante et autres turgescences en folie.
Dans un précédent billet, j’écrivais (on est jamais mieux cité que par soi-même) : « Promodifa, c’est le tigre dans votre moteur. Mesdames : le chibre dans votre moiteur. 192 pages d’un plaisir pur et intense. Même lorsque ce n’est pas bon (et ce n’est jamais bon !), ça fait du bien. »
Nouvel exemple aujourd’hui avec le numéro 16 de la collection Mystérotic : Intox-export, signé John Lee – un pseudonyme de Michel Grebbel, l’un des deux auteurs-phares de chez Promodifa, responsable à lui tout seul d’une bonne moitié de la production maison.
Et pour le coup, je vais donner dans la nouveauté, cambuter la formule habituelle, analyser ce machin en une lecture chapitre par chapitre. Voila qui fait méchamment moderne, radicalement dans le vent, j’ai envie de dire : aussi disruptant qu’innovant.
Alors, accroche tes miches pendant que j’incube du ciboulot because, ça va diffracter !
CHAPITRE 1. Jim Hackman, « un fieffé coquin totalement dénué de scrupules, » contemple le port de Hong Kong depuis la baie-vitrée de son maousse burlingue de trafiquant d’opium plein d’oseille. Entre alors sa secrétaire, Tien Hung, une vietnamienne de seize ans encore vierge. Pris de cette subite inspiration qui se traduit par une raideur vers l’aine (dixit Rimbaud), Hackman entreprend gaillardement la môme, histoire de reléguer au rayon pertes et fracas le berlingot de cette dernière.
« (…) les vietnamiennes étaient peut être moins expertes en amour que les Chinoises mais (…) elles avaient par contre la réputation d’être plus vicieuses. »
Nous n’en saurons pas plus car : « (…) il s’apprêtait à ouvrir sa braguette lorsque le vibreur de l’interphone l’interrompit. »
CHAPITRE 2. C’est un agent ripoux des Narcotiques qui demande une entrevue. Il a des informations à monnayer. Une fois l’importun évacué, Hackman reprend sa petite affaire là où il l’avait laissé. Et cette fois, c’est la bonne. Tien Hung se fait débrider.
« Pestant de la trouver si étroite, il dut batailler pour arriver à faire penetrer son énorme bourgeon dans la fragile corolle. »
CHAPITRE 3. Le héros entre en scène. Dans un Boeing 747 à destination de Hong-Kong, Richard Hamilton, agent du FBI chargé d’enquêter sur les agissements d’Hackman, drague une journaliste anglaise, blonde et ravissante. Les toilettes de l’appareil étant hors-service, ils ne peuvent concrétiser leur flirt. Le lecteur ronge son frein.
CHAPITRE 4. Arrivé à Hong-Kong, Richard rencontre Tien Hung et lui propose un rencard galant à la cantoche de l’hôtel Hilton. Son frein passablement rongé, le lecteur s’attaque à la boite à vitesse. L’auteur recevra-t-il ce subtil message ?
CHAPITRE 5. Réponse affirmative. Le dîner aux chandelles s’avère fructueux. Richard invite Tien Hung à monter chez lui – et ce n’est pas pour sucer des glaçons ou mater des estampes. « Tout en la caressant avec une douceur infinie, il pénétra sans hâte dans le sanctuaire palpitant, s’enfonçant avec précaution dans l’étroit fourreau, remontant lentement jusqu’au fond du calice. »
Contrairement au méchant, notre héros est un vrai gentleman.
(coupure publicitaire)
(fin de la coupure publicitaire)
CHAPITRE 6. Richard enquête sur Hackman pendant huit longues pages puis croise la journaliste anglaise du chapitre trois. Ils échangent alors des banalités romantiques super-chiantes pendant quatre pages sans même se rendre compte que la vie est courte, que chaque seconde compte, que le temps perdu ne revient plus, bref, qu’ils feraient mieux de s’envoyer en l’air illico. Raté. « Il alluma une cigarette en se traitant d’imbécile. »
CHAPITRE 7. Richard est mélancolique. Il boit du ouiski. Il s’emmerde vigoureusement. Nous aussi. Heureusement, Tien Hung débarque. L’asiatique connaît la musique. Elle libère « le mâle organe de ses entraves, le faisant jaillir au dehors entre ses doigts agiles. » L’alexandrin n’était pas loin et Richard se trouve « ébloui par les enivrants frôlements de cette étrange prière. »
CHAPITRE 8. Veuillez patienter – ne quittez pas – un correspondant cherche peut-être à vous joindre.
CHAPITRE 9. Le premier coup de feu est tiré. Nous sommes en page 131. Qui dit mieux ?
CHAPITRE 10. L’auteur met le turbo. Richard est traqué par les méchants. Tien Hung se fait kidnapper. N’ayant plus sa mousmé sous la pogne, le héros s’envoie la blonde journaliste des chapitres trois et six.
« – Ooooh !… Richard… gémit-elle en s’ouvrant davantage. Si tu savais… si tu savais comme j’en avais envie… »
CHAPITRE 11. Tout ragaillardi, Richard repart au schproum, fout le rif à des jonques remplies d’armes et de schnouf puis sauve Tien (qui vaut mieux que deux tu l’auras) des griffes des méchants, tous kaput. Le lecteur est heureux, le roman est fini.
BILAN. On peut s’avouer déçu. Vingt-cinq pages de gambettes en l’air sans fantaisies, deux molles fusillades, une vague course-poursuite ; ça fait pas lerche. Le roman manque cruellement d’action. C’est du Promodifa service minimum. Néanmoins, avec un prix de vente en Emmaüs et vide-grenier tournant aux alentours de 50 centimes d’euros (auquel il faut rajouter le prix d’un pack de kronenbourg, soit approximativement 3 euros 42), nous aboutissons à un coût de revient d’environ 0,02 centimes la page.
Si l’on compare avec une sortie récente de chez Gallimuche, par exemple le dernier Jean d’Ormesson qui, lui, coûte 6 centimes la page (et sans les kronenbourg), il n’y a pas à tortiller : Promodifa l’emporte haut la main.
Bref, pour faire court, en abrégé des agrégés : C.Q.F.D.
—
Intox-export, John Lee
éditions Promodifa / Mystérotic # 16, 1975.
—