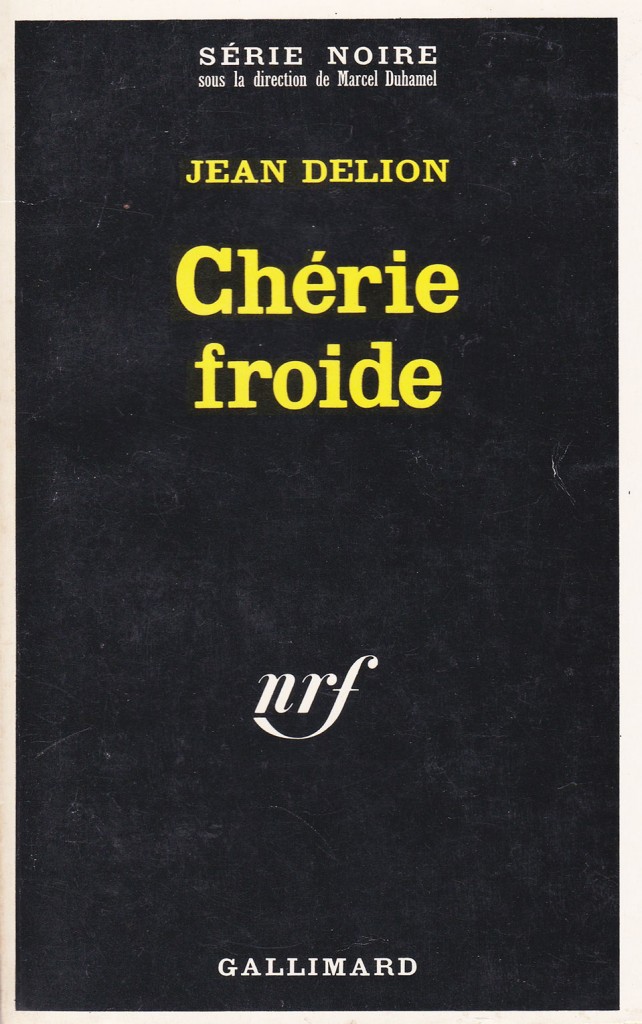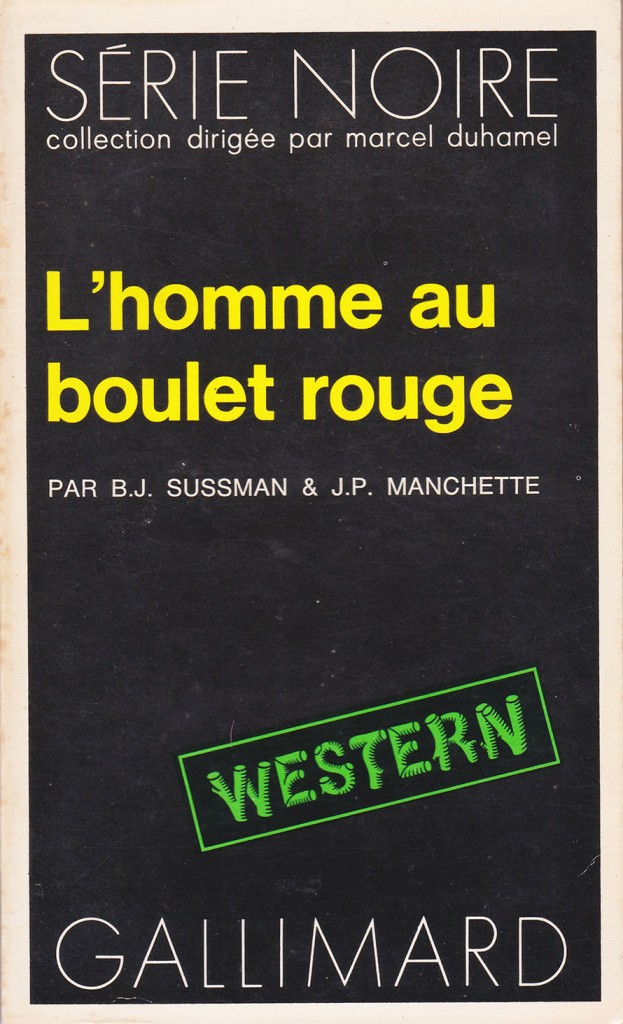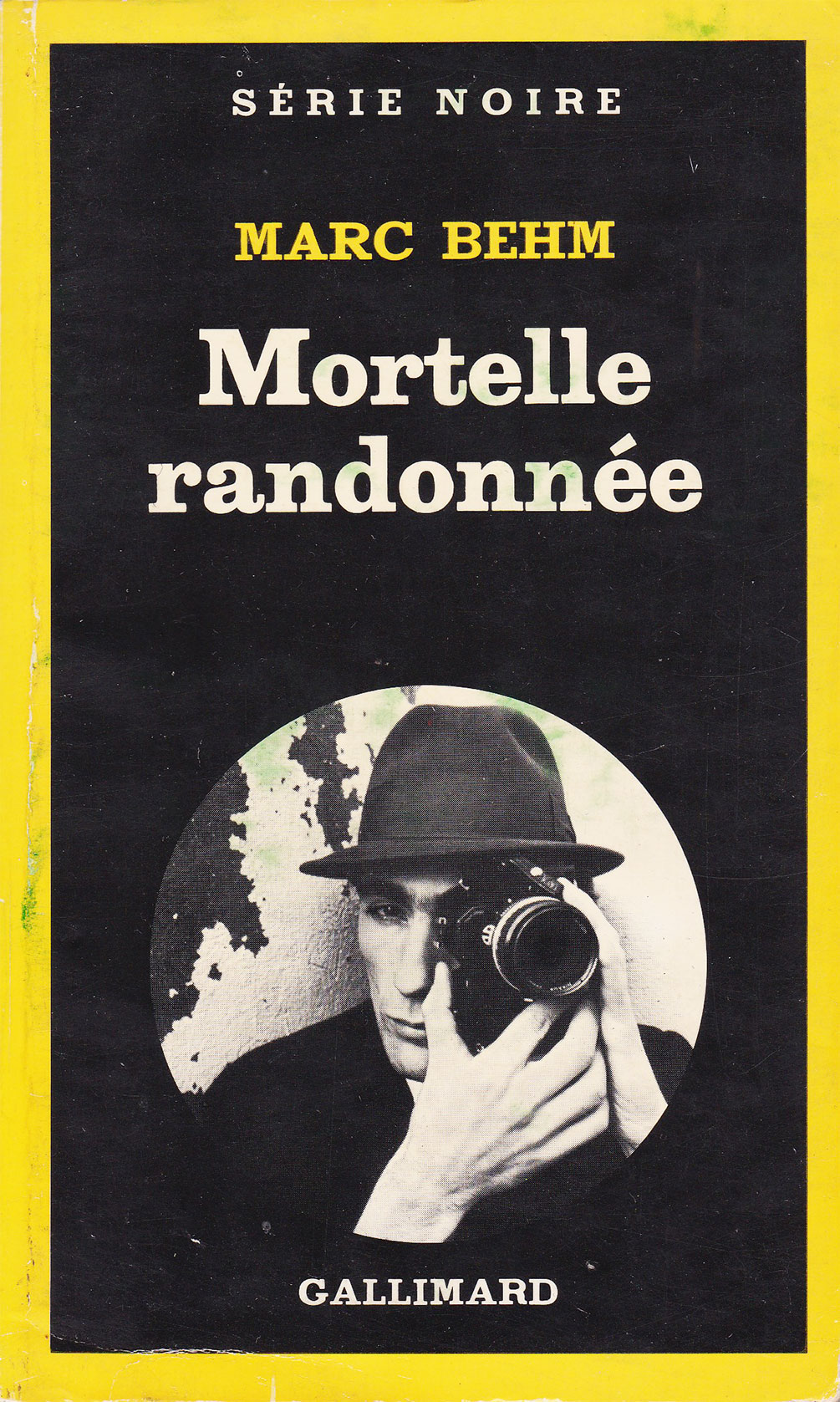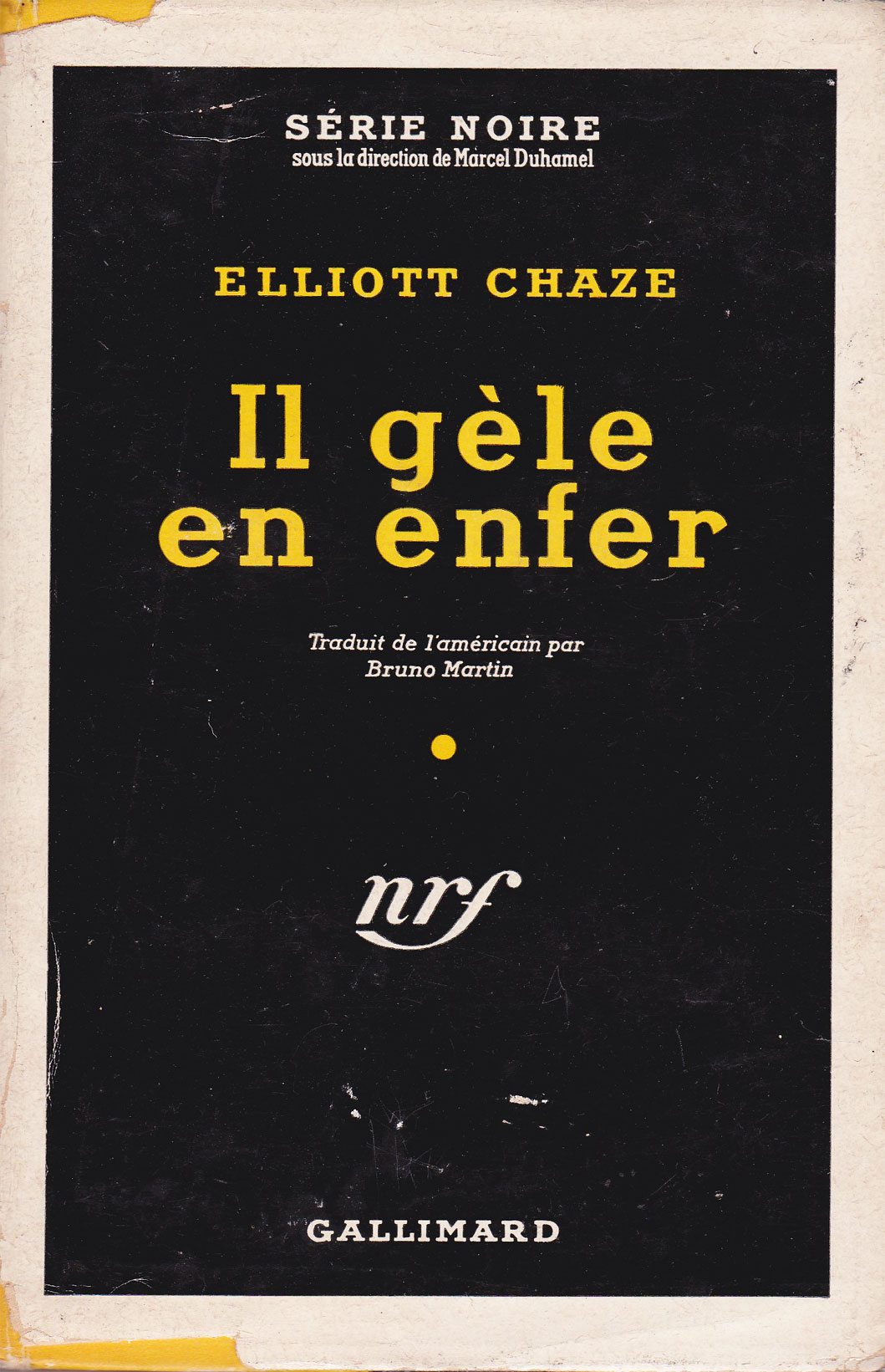On connaît la formule ; elle est de Paul Valery. Il y a trois sortes de femmes : les emmerdantes, les emmerdeuses et les emmerderesses.
Haut lieu du machisme lettré, la Série Noire fit sienne cette proposition – dédaignant les emmerdantes, raffolant des emmerdeuses, se montrant chiche en emmerderesses.
Les plus rares sont les plus précieuses.
Deux me viennent automatiquement à l’esprit : la Eva de James Hadley Chase et la Chérie froide de Jean Delion.
On ne présente plus la première, prostituée pernicieuse interprétée à l’écran par Jeanne Moreau. La seconde, par contre, est plus obscure. Qui se souvient de Jean Delion, alias Raf Vallet, alias Jean Laborde ? Pas grand monde et c’est dommage.
Chroniqueur judiciaire, grand reporter et romancier, il usina au mitan des années 60 une petite dizaine de romans populaires d’excellente facture.
Il y eu d’abord une série d’espionnage chez Plon, publiée sous son vrai blase, et dans laquelle un agent secret français s’opposait aux manœuvres machiavéliques d’une mata-hari nouvelle vague, Olivia – « tendre, cruelle, exquise ou sadique suivant les heures. » La cinecitta en fit un film d’espionnage fauché, Le Tigre sort sans sa mère, avec Roger Hanin et Margaret Lee. Laborde, lui, avait déjà rebondi à la Série Noire et donnait, sous le pseudonyme de Jean Delion, quelques romans noirs à l’humour de la même couleur.
Ainsi, ce Chérie Froide, dans lequel une femme du monde, authentique glaçon et monument de narcissisme cynique, décide de supprimer ses amants dans les cocktails littéraires, les réceptions mondaines et autres raouts huppés. Une goûte de cyanure versée en loucedé dans un whisky-on-the-rock et c’est plié, avec en prime l’assurance du crime parfait. L’aiguille dans une botte de foin. Allez retrouver un assassin silencieux parmi deux-cents autres suspects formant une même foule bruyante, pépiante et clabaudante.
La formule fait florès, et la meurtrière des émules. La voila secondée dans ses œuvres par un jeune romancier plus raté que maudit, croisement improbable entre Jean Isidore Isou et Jean-Edern Hallier, et qui souhaite liquider ses adversaires littéraires comme elle les hommes ne l’ayant pas fait grimper aux rideaux.
S’en suit un jeu de massacre aussi impitoyable que réjouissant. Le tout-Paris y passe, le gotha trépasse. Ministres, cinéastes, écrivains, journalistes, couturiers, starlettes, playboys, jet-setters, sultans. L’œil exercé aux pages mondaines du Paris Match d’antan en reconnaîtra certains – José Luis Villalonga, Mireille Darc, Eddie Barclay, Françoise Sagan. Le roman est à clef mais sans ostentation.
Tout cela fini bien évidemment dans le chaos le plus total. La farce vire à la fantaisie ravageuse. Le cyanure n’était qu’une mise de départ que Jean Delion fait fructifier jusqu’au trinitrotoluène.
« Comment l’esprit vient aux filles ? » se demande-t-il en page 202.
Réponse de circonstance : « En liquidant les garçons. »
—
Chérie froide, Jean Delion
éditions Gallimard / Série Noire # 1145, 1967.
—