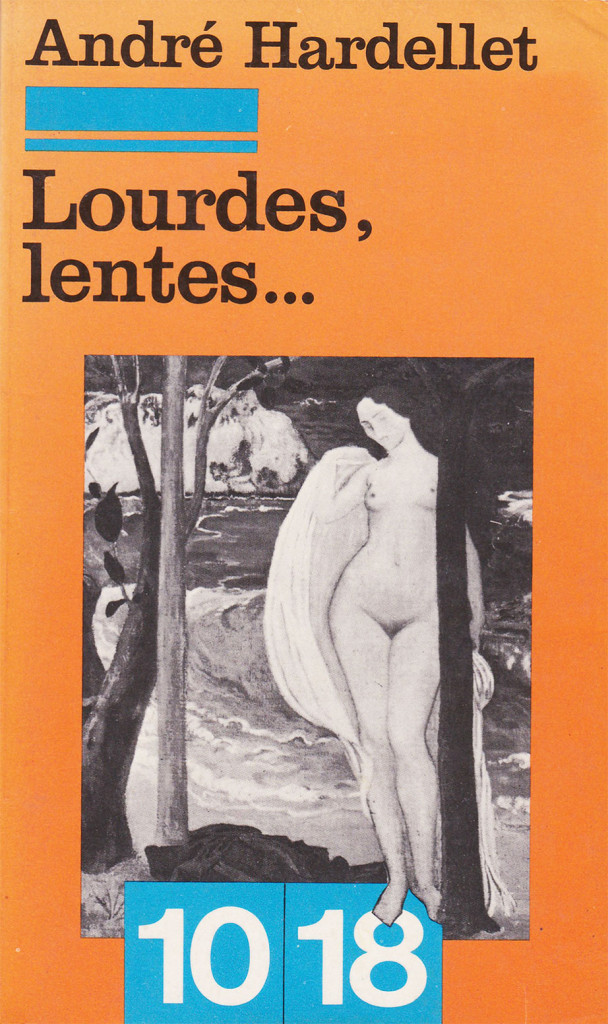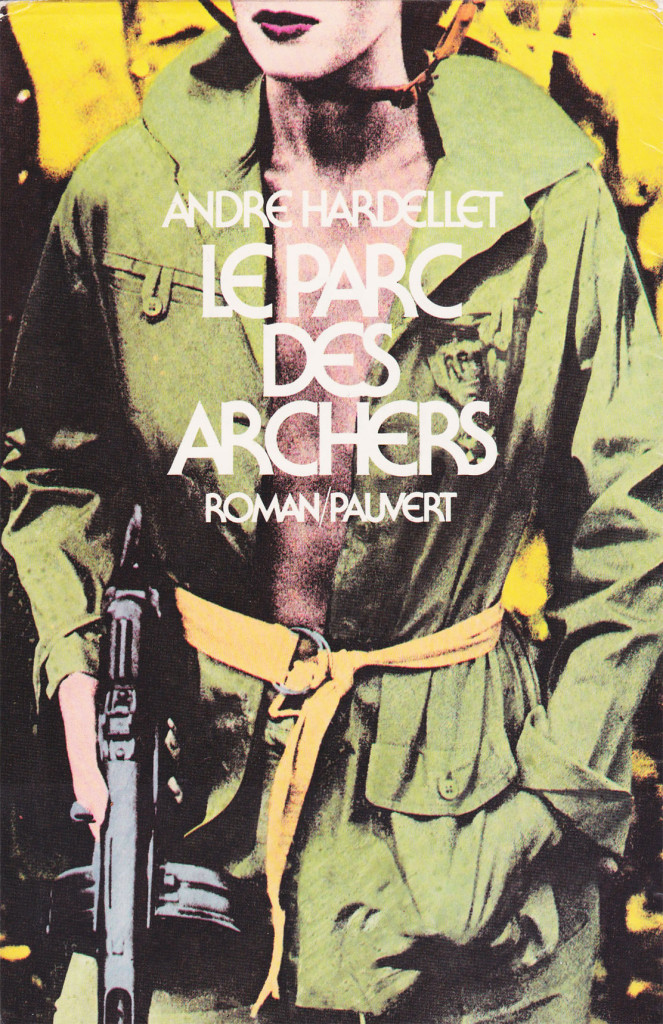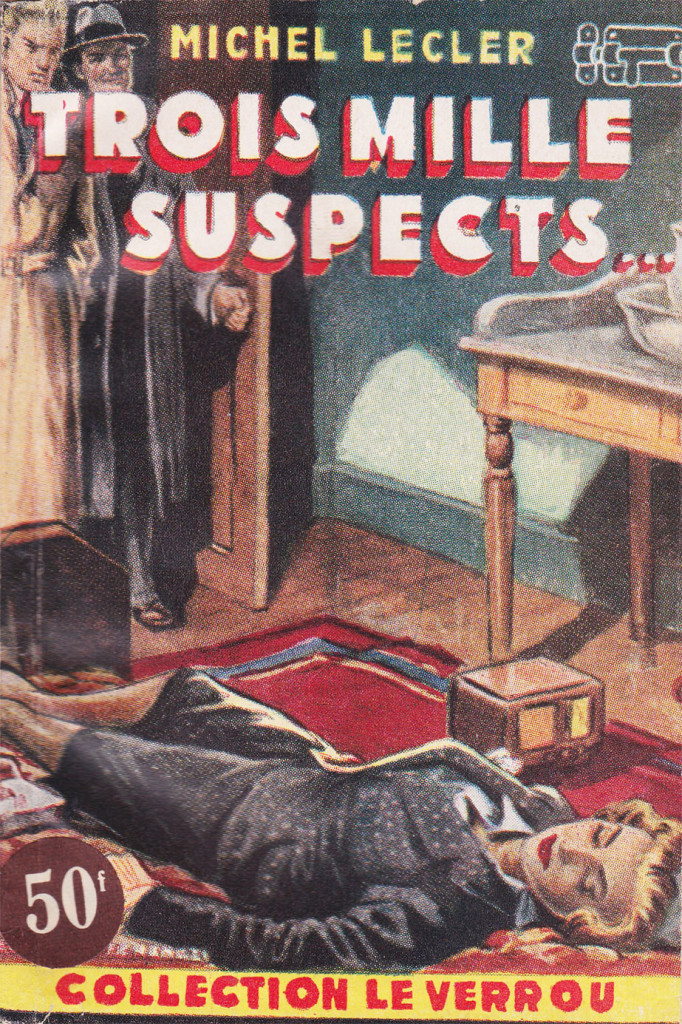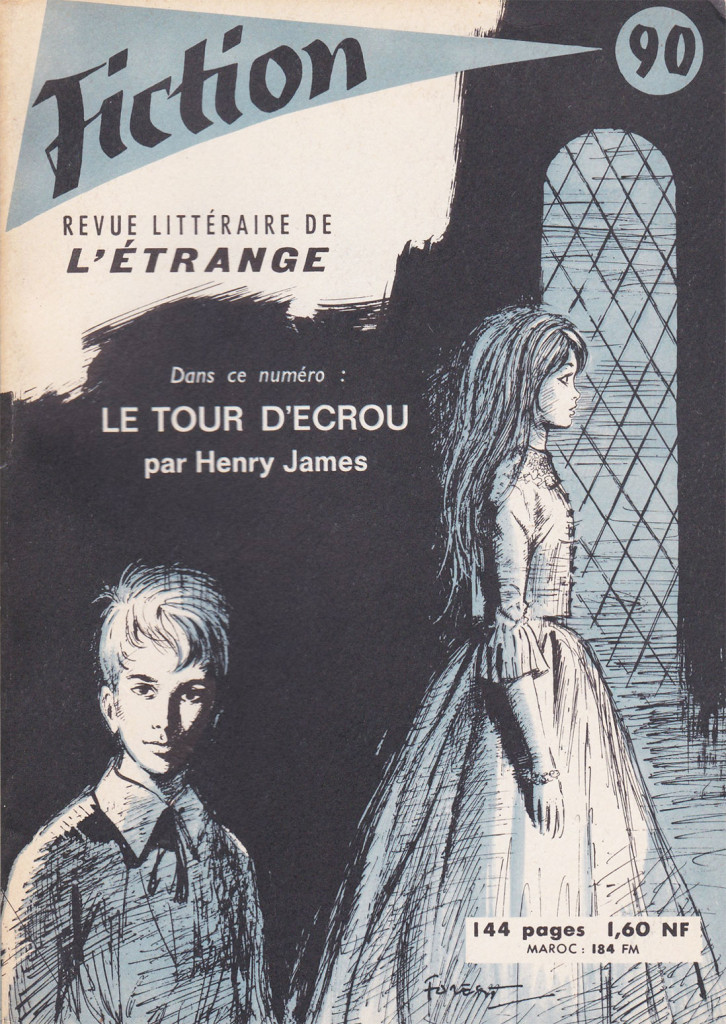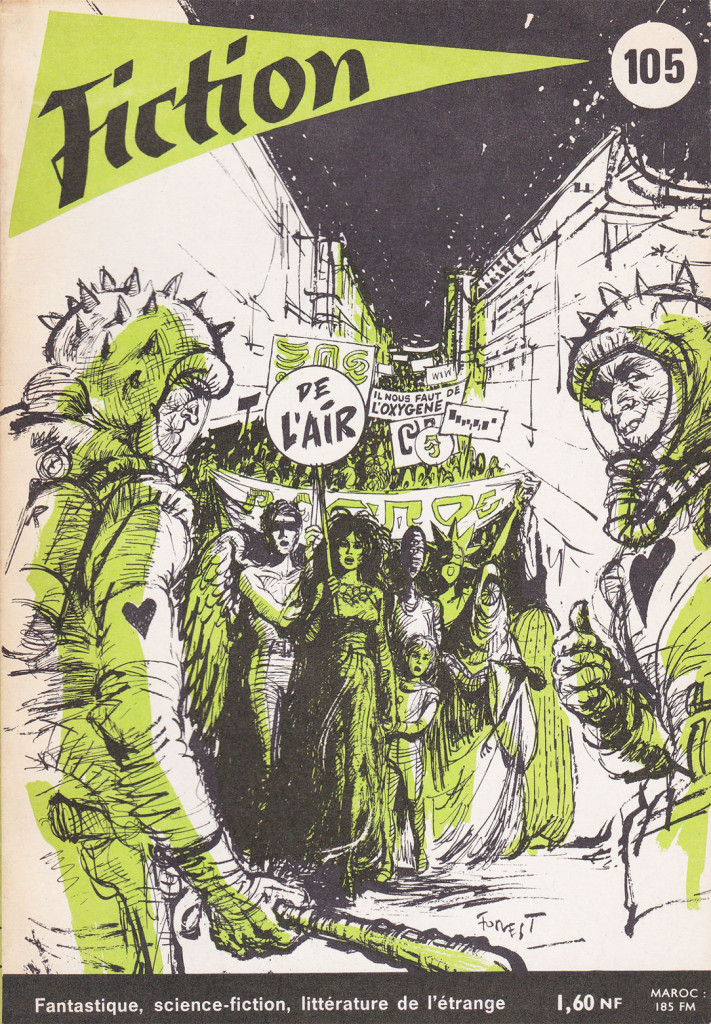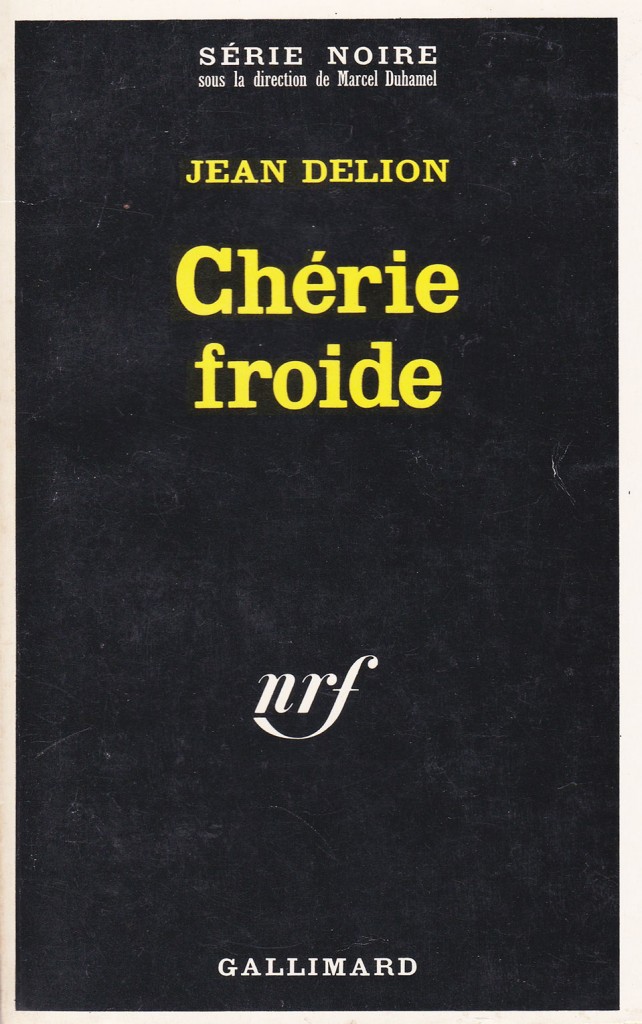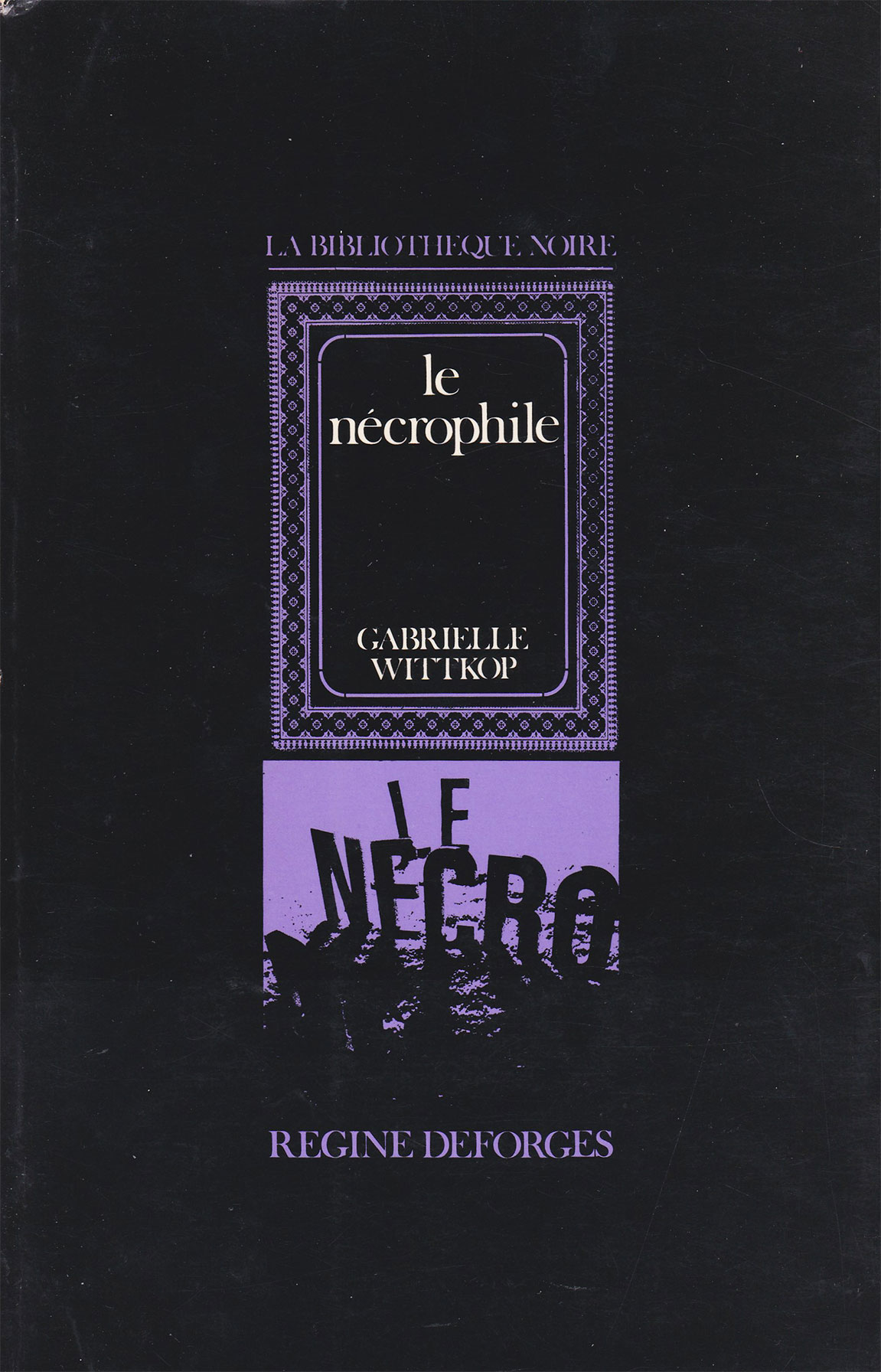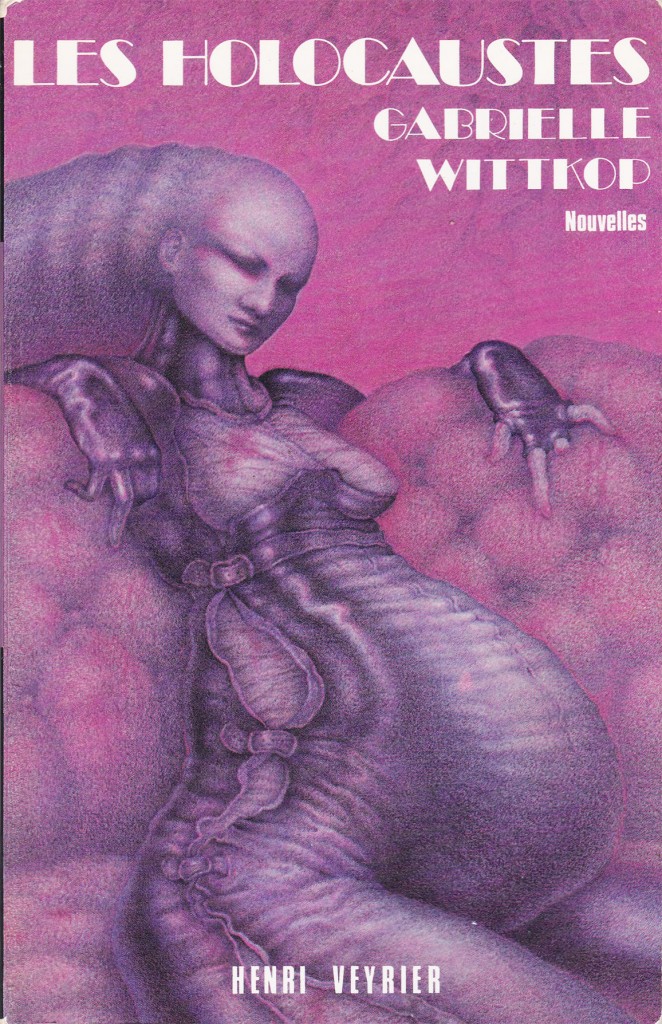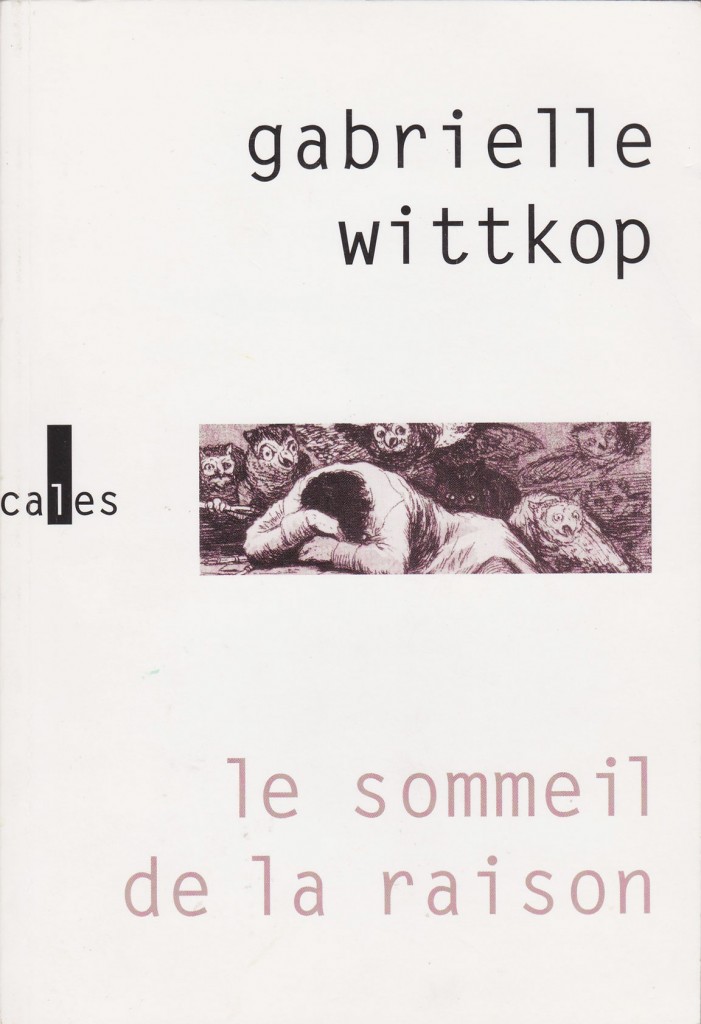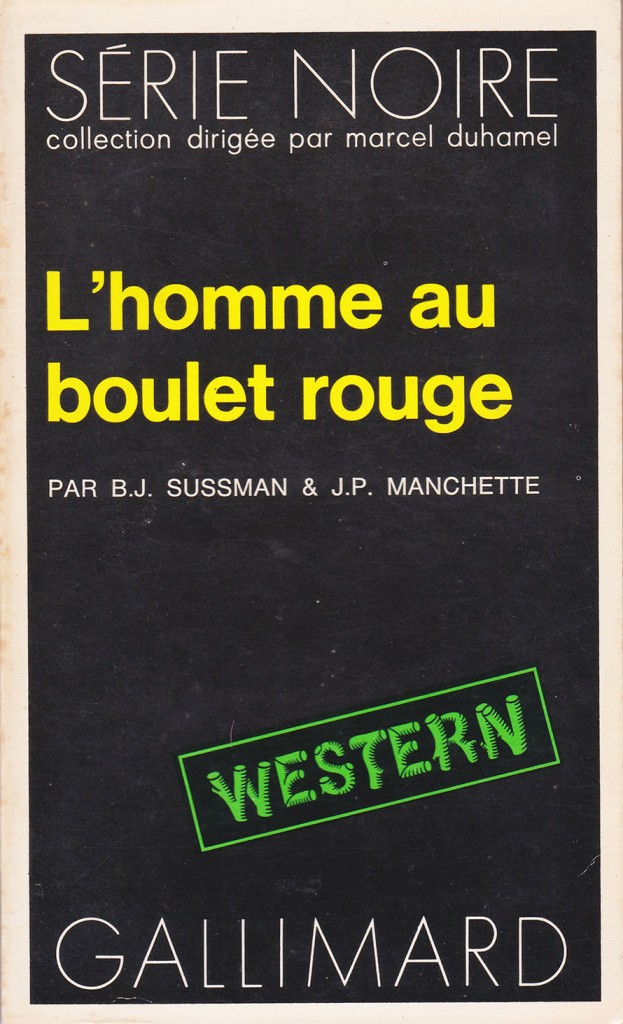Bien avant d’être exercée en ligne, et gratuitement, par des individus aux motivations aussi confuses que post-modernes, la censure était une activité dont se chargeait l’État avec un zèle tout proverbial.
En 1973, l’écrivain André Hardellet en fit les frais de façon assez sinistre. Celui au sujet duquel Guy Dupré notait fort joliment « écrivain mineur si l’on ajoute : de grand fond » tissait dans son ultime roman Lourdes, lentes… un chant d’amour à ces femmes que Maillol se plaisait à sculpter.
Lourdes, lentes, Hardellet les aimait ainsi ; corpulentes.
Dans ce livre, troisième et dernière exploration romanesque de ces rivages incertains où se récolte l’or du temps, Stève Masson, un double de l’auteur, raconte son initiation charnelle à l’entrée de l’adolescence par Germaine, une jeune fille de vingt-deux ans, lourde, lente.
« On ne fait pas l’amour » y écrit Hardellet, « c’est lui qui vous fait. »
Présidée par Mr. Hennion, la XVIIe chambre correctionnelle ne vit pas les choses de la même façon. Lourdes, lentes... fut condamné pour « outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre » – le roman étant, selon ces chancres de la loi, « qu’un prétexte à des descriptions scabreuses. »
Dans son Histoires de censure, Bernard Joubert détaille sur plus de six pages tous les griefs émis à l’encontre du texte d’Hardellet.
Lui qui s’imaginait chasseur d’Horizon voyait le sien réduit aux dimensions d’un procès verbal. Gifle aussi cinglante que cruelle, à l’image du président Hennion ordonnant à l’auteur de retirer les mains de ses poches : « Cessez de vous tripoter, monsieur Hardellet. »
Dans Mes ports d’attache, Louis Nucéra évoque « un enfant de cinquante-huit ans » pleurant face aux juges. « L’écriture lui avait permis d’assouvir ses ardeurs, de les magnifier, d’en reculer les bornes. Dans la bouche d’un magistrat citant des passages, la poésie avait fichu le camp. »
Condamné la même année pour son Château de cène, Bernard Noël parlait d’« outrage aux mots » et de « sensure. » Car dans la bouche des magistrats, le sens aussi avait fichu le camp.
Au lendemain de la condamnation, et quelques mois avant de calancher, André Hardellet écrivit à son ami Hubert Juin : « ce qu’ils entendent punir en moi (…) est avant tout une manière d’être, de sentir, un style d’existence qui restera toujours très au-dessus de leurs moyens. »
Ce style d’existence, Hardellet en avait donné un aperçu dans son précédent roman, Le parc des archers.
Publié sans grand succès en 1961, ce récit d’anticipation rêveur s’attache aux pas d’un écrivain recherchant un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens pour nier l’époque émolliente et factice qu’il se voit contraint à arpenter. Le présent lui apparaît comme « une lente et sournoise dégradation (…) du bonheur et de la volonté du bonheur » et ses contemporains comme « un peuple nourri de minces équations, de mots d’ordre, de slogans, qu’il s’agît de métaphysique ou de lames de rasoir, de poésie ou d’appareils ménagers. »
« La spontanéité n’avait plus cours. (…) Les poncifs traditionnels : adaptez-vous, vivez avec votre époque, etc. servaient toujours d’attrape-nigauds avec un succès désarmant. Les bons apôtres citaient Rimbaud, affirmant qu’il faut être résolument moderne, mais négligeaient une autre phrase, gênante, du même poète : ‘Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente.‘ »
Chez nos censeurs actuels, tous très connectés, tous très très modernes, la vraie vie aussi semble absente.
Récemment, une jeune américaine férue de citations motivationelles (sic), de management et de finance en ligne, demandait à un musée new-yorkais le retrait d’une toile de Balthus.
La sensualité de cette œuvre n’était pas sienne, n’était surtout pas convenable (et l’imagine-t-on, cette jeune américaine, lisant les livres du frère de Balthus, Pierre Klossowski ?) ; donc cette œuvre se devait d’être effacée des murs, éloignée des regards et questionnée, comme d’autres questionnent des délinquants, avec les méthodes qu’on leur connaît.
De fait, il est intéressant de noter que ces activistes ignares qui demandent le retrait d’un Balthus ou d’un quelconque préraphaélite, ces aimables touristes d’un culturel qu’ils souhaitent lisse et organisé comme un brunch de salades détox, substituent à la notion de censure une soi-disant « invitation au débat. »
Que leur débat débute par une interdiction ne semble pas les déranger outre mesure.
Paradoxe peu étonnant si l’on considère que leurs réflexions naissent et se développent, pour l’essentiel, sur des fils d’actualité aux entrées limitées à deux-cent quatre-vingt caractères et ne voyant pas plus loin que le bout de leur mot-balise.
Ainsi s’exerce une pensée en réduction, une pensée lyophilisée.
Ajoutez de l’eau, vous obtenez des grumeaux.
Il est certain qu’André Hardellet, largement réédité chez Gallimard, ne sera jamais plus condamné, ni même invité au débat et questionné par ces vivants-morts que la chambre d’écho de l’instant même consume inlassablement. Mais cela demeure un détail tout à fait mineur dans le paysage clos et rectangulaire qui est le sien depuis plus de quarante ans.
Plus inquiétant par contre est l’état de notre propre paysage.
Comme ne cesse de le répéter Annie Le Brun, « on ne peut douter que la dévastation de la forêt naturelle va de pair avec celle de la forêt mentale. »
Ainsi, du béton qui englouti l’équivalent d’un département français tous les sept ans à l’addiction technologique poussée jusqu’à l’effacement de toute zone grise, de la disparition programmée d’espèces entières d’oiseaux à ces villes qui ne répondent plus qu’au double impératif commercial et répressif, on ne s’étonnera guère que le paysage extérieur général augure chez certains d’une intériorité peu désirable.
De là à l’accepter, voire à simplement s’en accommoder, il n’y a qu’un pas ; puisque nous y vivons, avec eux, dans cet extérieur même où s’exprime leur intérieur.
Je repense à ce moment où, dans Le parc des archers, Stève Masson apparaît. Le roman semble alors (à moins qu’il ne s’agisse d’un leurre du temps et de l’espace) faire suite aux événements du précédent, Le seuil du jardin.
Ancien peintre à succès, Masson a désormais tout perdu, l’horizon et le bonheur. Devenu clochard et rendu à moitié fou par des expériences passées autant que par les temps présents, il évoque dans ses rares moments de lucidité cette saison où il peut s’étendre de tout son corps comme de tout son imaginaire : l’été.
Pour nous, malheureusement, l’hiver ne fait que commencer.
—
Ci-dessus :
Le seuil du jardin, chez Jean-Jacques Pauvert éditeur,
collection Les Indes Noires # 3, 1966
Le parc des archers, chez Jean Jacques Pauvert éditeur, 1977
Lourdes, lentes…, chez Christian Bourgois, 10/18 # 1164, 1977
—